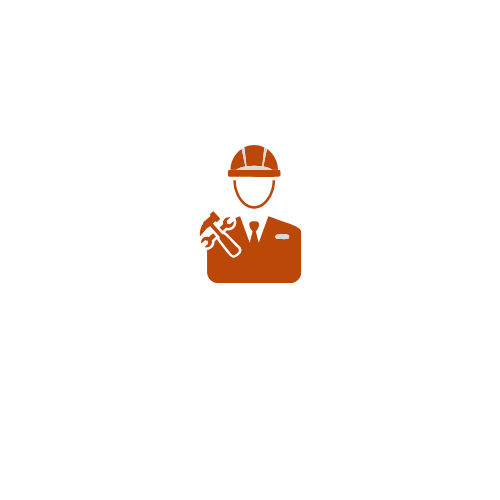Arrêt Cousin : Quand la responsabilité civile du préposé dépasse ses frontières #
Émergence d’une exception à l’immunité du préposé #
L’immunité civile du préposé, issue de l’arrêt Costedoat rendu le 25 février 2000 par la Cour de cassation, établissait comme principe que le préposé n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers lorsqu’il agit sans excéder les limites de sa mission confiée par le commettant (employeur). Cette solution, consacrée à l’époque dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la hiérarchie professionnelle, permettait à l’employé d’être à l’abri d’actions en réparation si son acte dommageable intervenait dans l’exercice de ses fonctions.
Or, l’arrêt Cousin (Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n°00-82.066) crée une dérogation de taille à ce principe. En jugeant qu’un préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction, y compris sur instruction du commettant, engage sa responsabilité civile, même face à la victime d’un dommage, la Cour de cassation bouleverse l’équilibre établi. Ce revirement trouve sa justification dans la volonté de ne pas permettre qu’un salarié puisse se retrancher derrière l’ordre de l’employeur pour se soustraire à ses responsabilités lorsqu’il commet une infraction pénale intentionnelle constituée dans tous ses éléments.
- Infraction pénale intentionnelle : Faux, usage de faux, escroquerie, délits financiers sanctionnés pénalement, comme le cas de Monsieur Cousin, comptable condamné pour avoir frauduleusement obtenu des subventions pour le compte de la société qui l’employait à Paris en 2001.
- Absence de protection : Le fait que l’infraction ait été commise sur ordre du commettant ne fait pas barrage à l’engagement de la responsabilité du préposé.
- Innovations de l’arrêt : Possibilité pour la victime d’obtenir réparation auprès du préposé, indépendamment du recours contre l’employeur.
L’articulation entre responsabilité pénale et civile dans l’arrêt Cousin #
La Cour de cassation opère un rapprochement inédit entre responsabilité pénale et responsabilité civile, en jugeant que la condamnation pénale du préposé pour une infraction intentionnelle a pour corollaire l’engagement automatique de sa responsabilité civile vis-à-vis du tiers lésé. La coexistence de ces deux sanctions, loin d’être redondante, répond à l’aspiration du législateur à garantir la réparation intégrale du préjudice causé par l’infraction.
À lire Calcul du 13e mois au prorata : conseils pratiques pour optimiser votre rémunération
Sur le terrain pratique, cette articulation se traduit par l’obligation, pour le préposé condamné pénalement, d’indemniser personnellement la victime, même si celle-ci dispose par ailleurs du recours contre le commettant. Ainsi, la Cour de cassation impose que la responsabilité personnelle du fautif soit engagée, sans distinction selon que l’ordre vienne ou non du supérieur hiérarchique. Cette coexistence ouvre la voie à multiples contentieux impliquant :
- Des actions civiles parallèles à la procédure pénale, dirigées contre le préposé pour obtenir réparation du préjudice.
- Des procédures où la preuve de la condamnation pénale simplifie l’établissement de la faute civile, renforçant la sécurité de la victime dans l’accès à l’indemnisation.
- La multiplication des recours en solidarité, mettant en évidence les intérêts divergents entre l’entreprise et son salarié.
Impact sur la relation commettant–préposé : partage et recours en responsabilité #
Ce nouvel état du droit, initié par l’arrêt Cousin, crée une situation où la victime dispose de deux débiteurs principaux : l’entreprise (commettant), réputée plus solvable, et le préposé, responsable à titre personnel. L’effet notable est la transformation des équilibres de la chaîne de responsabilité : l’employeur n’est plus systématiquement le seul garant envers les tiers, mais voit naître la possibilité d’un recours en responsabilité contre son salarié, sous réserve que la faute ait été commise sans ordre exprès ou que cette faute dépasse le cadre de la mission habituelle.
Les répercussions sur la gestion du risque et la politique managériale sont considérables. Les directions juridiques de groupes tels que BNP Paribas, secteur banque, ou AXA France, secteur assurance, intègrent désormais des clauses de prévention spécifiques dans les contrats et les programmes de formation, à la suite d’incidents où la faute intentionnelle de certains préposés a généré des condamnations à titre personnel.
- Double débiteur : L’employeur et le préposé répondent tous deux du préjudice envers la victime.
- Recours du commettant : L’employeur ayant indemnisé la victime peut agir contre le salarié lorsque la faute n’a pas été commanditée expressément.
- Montée du risque disciplinaire : Les DRH de grands groupes à Paris comme LVMH ou EssilorLuxottica évaluent l’incidence de ces décisions sur la discipline interne et la culture d’entreprise.
Comparaison avec la jurisprudence antérieure #
L’arrêt Cousin s’inscrit dans une rupture flagrante avec la jurisprudence Costedoat du 25 février 2000. Avant Cousin, le préposé bénéficiait d’une immunité civile complète dès lors qu’il agissait dans la limite de sa mission. Ce principe visait à protéger les salariés de poursuites individuelles qui auraient pu les exposer à des risques financiers majeurs, réservant la charge finale à l’employeur, mieux assuré et capable d’assumer le coût des indemnisations.
Après le revirement opéré en 2001, seuls les actes constitutifs d’infractions pénales intentionnelles commises même sur ordre du commettant échappent à cette immunité. Dans les affaires récentes, telles que celles impliquant des responsables comptables condamnés pour escroquerie, les juridictions civiles ont statué dans la droite ligne de Cousin, renforçant la tendance à responsabiliser personnellement les auteurs de fautes lourdes, tout en ménageant le recours de l’entreprise employeuse contre ceux-ci.
- Avant 2001 : Immunité du préposé, responsabilité quasi exclusive du commettant, comme illustré par des affaires impliquant la Société Générale durant les années 1990.
- Après Cousin : Limitation de l’immunité, possibilité de poursuite directe du préposé, particulièrement marquée dans des cas de fausses facturations dans le secteur public à Paris et Lyon en 2003 et 2004.
Conséquences pratiques pour les victimes d’infractions commises par un salarié #
La décision Cousin octroie aux victimes de nouveaux leviers pour obtenir réparation rapide et intégrale. Désormais, toute personne subissant un préjudice du fait d’un salarié reconnu coupable d’une infraction pénale intentionnelle peut engager, parallèlement, la responsabilité de l’entreprise et celle du salarié. Ce mécanisme simplifie la preuve de la faute et accélère les procédures, limitant les effets du risque d’insolvabilité d’un seul des débiteurs.
Concrètement, lors d’affaires de fraude dans le secteur de la grande distribution en Île-de-France (2022), des victimes ont pu se prévaloir des solutions issues de Cousin pour agir à la fois contre des directeurs de magasin condamnés pour détournement de fonds et contre leur groupe employeur, Carrefour France. La prévalence de l’action directe contre le préposé rééquilibre la position des victimes, jusque-là tenues de s’en remettre à la solvabilité du seul commettant.
- Possibilité pour la victime d’agir simultanément contre le salarié et l’employeur.
- Facilitation de la reconnaissance du préjudice, du fait de la présomption de responsabilité civile en cas de condamnation pénale intentionnelle.
- Protection accrue dans des domaines sensibles, comme le secteur médical, où des patients victimes d’actes intentionnels peuvent engager plus aisément la responsabilité directe d’un professionnel fautif.
Débats actuels et perspectives d’évolution #
L’arrêt Cousin, en suscitant de vives controverses doctrinales et pratiques, oblige à repenser la notion de responsabilité individuelle à l’ère du collectif au travail. Les débats se cristallisent autour des risques d’instrumentalisation de la procédure civile, du danger de voir la relation de subordination professionnelle devenir source de conflits judiciaires endémiques, et de la nécessité d’une législation plus précise pour encadrer la définition de la faute pénale intentionnelle.
Les syndicats comme la CFDT et les fédérations patronales de la Fédération Syntec (ingénierie numérique) ont officiellement interpellé, en 2023, le ministère de la Justice à Paris pour clarifier la frontière entre faute professionnelle et infraction intentionnelle, notamment dans les secteurs où la délégation de pouvoir est massive. La doctrine suggère des évolutions, allant de l’introduction d’un filtre judiciaire systématique avant toute action civile individuelle contre le préposé, à la création de mécanismes d’assurance spécifique pour les cas d’engagement personnel.
- Tensions entre sécurité juridique de l’employeur et impératif de protection de la victime, attestées par les recours déposés au Conseil d’État depuis 2021.
- Pistes envisagées : Réforme du Code civil pour préciser la notion de faute intentionnelle, développement de l’assurance responsabilité civile individuelle obligatoire dans certains secteurs à risque.
- Réunion du Comité consultatif national d’éthique en 2024, débattant de la charge morale pesant sur le salarié visé par une double action pénale et civile.
Il serait légitime, au regard de l’évolution sociale comme des impératifs de justice, d’envisager une réforme coordonnée, articulant meilleure protection de la victime, sécurité pour l’entreprise, et équilibre du contrat de travail, en tirant parti de l’expérience accumulée depuis l’arrêt Cousin et en prenant en compte les mutations actuelles du monde professionnel.
Plan de l'article
- Arrêt Cousin : Quand la responsabilité civile du préposé dépasse ses frontières
- Émergence d’une exception à l’immunité du préposé
- L’articulation entre responsabilité pénale et civile dans l’arrêt Cousin
- Impact sur la relation commettant–préposé : partage et recours en responsabilité
- Comparaison avec la jurisprudence antérieure
- Conséquences pratiques pour les victimes d’infractions commises par un salarié
- Débats actuels et perspectives d’évolution